|
12 février, Journée Internationale
des enfants soldats
Enfant soldat Mai Mai, Nord Kivu, République démocratique du Congo. © Private.
Une journée pour rappeler que des milliers de garçons et de filles dans le monde sont enrôlés contraints ou forcés comme enfants soldats.
« Ils nous entrainaient à tirer en nous disant de viser
le cœur ou les pieds. » Ce témoignage d'un enfant soldat a été recueilli par Amnesty International au Mali dans la région de Segou fin janvier 2012. Lors de cette mission, la quatrième menée au Mali par l'association depuis le début du conflit, Amnesty International a recueilli des informations confirmant le recours aux enfants soldats.
On dénombre 250.000 enfants soldats dans le monde. Privés de leur enfance, ils se retrouvent en premières lignes lors des combats, parfois au péril de leur vie.
L'utilisation d'enfants-soldats demeure l'un des fléaux les plus importants de notre siècle, en termes de droits humains.
Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à enquêter et dénoncer l'utilisation d'enfants soldats afin qu'elle cesse.
Avec votre don, soutenez le combat d'Amnesty et permettez-nous d'enquêter, alerter et agir contre toutes les violations des droits humains dans le monde.
|
|
AZURCOM - Page 51
-
ENFANTS SOLDATS
-
LE RETOUR
Aprés une semaine de vacances , je suis de retour et , voilà le résumé de mes activités
Zapper le « Bonjour » de Patrick Cohen quelques secondes avant 7 heures.
Boire son café avec croissant mais sans radio.
Ne pas lire le flux RSS de Google News.
Refuser l’édito de Thomas Legrand.
Récuser l’entretien de Pascale Clark, et celui de Jean-Michel Aphatie.
Ne pas chercher qui était interviewé vers 7h20 sur France Info, France Inter ou Europe1.
Ne pas partir au boulot.
Embrasser sa femme .
Ne pas travailler.
Ne pasTweeter pendant les réunions inutiles.
Eviter la rage de certains, les chamailles des autres.
Ne plus regarder les débats du mariage pour tous sur le canal officiel de l’Assemblée nationale.
Se refuser à écouter la radio d’information , laisser l’écran de TV éteint au retour des pistes.
Ne pas survoler encore Twitter.
Ne pas réagir aux blogs critiques, aux critiques de blogs, aux critiques tout court ignorer les insultes du FdG .
Ne pas lire le Monde du soir, jeter directement le Libé matinal ou L'Equipe . La presse, ce mercredi, n'était pas en kiosque.
Ne pas lire le dernier newsmagazine emmener reçu ce weekend (pardon Le Nouvel Obs).
Pouvoir lire enfin entièrement le Monde Diplo aprés une sévère chute
Ne pas se brancher sur iTélé.
Oublier les résultats du Stade de Reims .
L’envie est partie, toute seule.
C’ était bon.
-
LE COW BOY D'AUBERVILLIERS :je n'ai pas pu résister
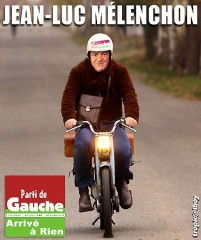
C´est moi l´cow-boy d´Aubervilliers
Mais mon chapeau c´est un béret
Mon ch´val c´est un solex
J´aimerais qu´on m´appelle Tex
Mais mon vrai nom, ben c´est René
C´est moi l´cow-boy d´Aubervilliers
Même que mes copains d´atelier
Dès que j´ai l´dos tourné
Disent que je suis cinglé
Eux qui ne savent pas rêver
Y a long-long-long longtemps
Que j´attends - oh oui
De voir le Texas et le Nevada
Mais le métro n´va pas jusqu´à là-bas
I´m the cow-boy from Aubervilliers
I am très connu Porte Champerret
Mais j´travaille chez Renault
C´est un sacré boulot - oui m´sieur
Pour un cow-boy d´Aubervilliers
J´suis plus rapide que l´grand Billy
Que l´grand Billy de Juvisy
Mais mon grand ennemi
C´est Jo, Jo de Champigny
Un jour ce sera moi ou lui
Mais...
Y a long-long-long longtemps
Que j´attends
De voir le Texas et le Nevada
Mais le métro n´va pas jusqu´à la-bas
Dans mon ranch à Aubervilliers
Si une fille pouvait m´aimer
On s´en irait à deux
Et on serait heureux
Dans les prairies d´Aubervilliers
Nous les cow-boys d´Aubervilliers -
ASSEZ DE HAINE
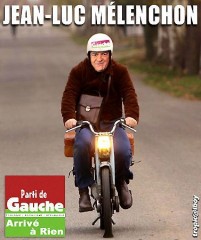
Je souhaiterai ici rappeler quelques faits qui n’ont rien d’une opinion personnelle:
1. Le candidat à la Présidence qui promettait de changer la lune plus 5%, le cours du temps et la courbe du chômage, et même éradiquer la pauvreté dans les deux ans s’appelait Nicolas Sarkozy. Ce président-là était dans la « survenchère » permanente. Il était normal, légitime, nécessaire, indispensable de tacler cette imposture aussi systématiquement qu’elle nous était opposée.
2. On peut reprocher à Hollande beaucoup de chose, mais pas n’importe quoi. A titre personnel, je ne lui reproche même pas qu’il ait échoué à renégocier le traité européen. Non pas que ce traité m’enchante, mais je n’ai jamais considéré sérieusement les promesses de résultats qui dépendaient d’autres que celui qui faisait la promesse.
3. La stabilité des effectifs de la fonction publique pendant la durée du quinquennat était une promesse du candidat Hollande. Ce fut écrit, dit et répété. Et comme, en parallèle, le même candidat promettait d’augmenter les effectifs de l’Education nationale, il ne fallait pas être grand clerc pour comprendre que d’autres filières allaient subir des réductions de postes. Tout autre raisonnement a posteriori est de la mauvaise foi ou de l’ignorance, choisissez.
4. La difficulté du combat politique et syndical actuel est que malgré une immense amélioration des techniques d’information, le besoin de caricaturer les enjeux reste essentiel. On se retrouve donc avec ce genre de slogan débile: « pour moi, rien n’a changé en 9 mois ».
5. En période de crise, les demandes de pouvoir d’achat supplémentaire sont inaudibles. Plus de trois millions de personnes n’ont carrément pas d’emploi. Il aurait mieux valu tancer le gouvernement sur la précarité, les écarts de rémunérations, l’engorgement de certains services, ou le manque de moyens.
6. Se plaindre de l’austérité prétendument à l’oeuvre en France est une bêtise.On peut critiquer l’absence de relance économique, le blocage de la croissance . L’austérité, chez nos voisins espagnols, britanniques ou grecs, c’est (entre autres) la réduction du nombre de fonctionnaires, de leurs salaires, de leurs retraites.
7. Les médias sont globalement hostiles à la cause publique: face à ces manifestations, d’hier comme d’avant-hier, on entend la même vulgate libérale (« ces fonctionnaires sont trop protégés et ils devraient fermer leur gueule »). Pas ici. Les fonctionnaires ont raison de râler. Mais il faut choisir ses slogans avec un peu de discernement.
-
LA DEUCHE : MON REVE
C'est la deuche, la deudeuche, la deux-pattes. La Citroën conçue pour la campagne et qui a terminé en citadine branchée, la décapotable la moins chère du marché que personne ne décapotait (alors que c'était tout simple). Une icône de la France, avec le béret, la baguette de pain et la tour Eiffel. Que le cinéma américain s'évertue à placer (avec la DS) dans chacun des films dont l'action se déroule en France. Même si le film se passe aujourd'hui, à une époque où la 2CV a depuis belle lurette déserté nos rues et ne constitue plus, aux yeux des plus jeunes, qu'une amusante curiosité.

42 ans de carrière
Un jour en 1990, Citroën a cessé de produire la 2CV. Personne n'en revenait et l'annonce méritait bien une petite larme. Car la 2CV, plus encore que les Renault 4CV et "4L", a mis la France d'après-guerre sur quatre roues pour de bon. Elle était immortelle. Plus grand-monde ne l'achetait mais personne ne voulait qu'elle disparaisse. Chaque année, elle figurait dans le catalogue Citroën, immuable alors que le monde continuait d'avancer. Direction assistée ? Verrouillage centralisé ? Vitres électriques ? Et pourquoi pas un essuie-glace arrière ou une climatisation ? La 2CV n'avait rien. C'était normal à sa sortie en 1948. C'était pur snobisme à la fin de sa carrière.

Un univers à part
Les vitres avant qui pivotent de bas en haut (puis retombent de haut en bas sur le bras accoudé à la portière) et ses vitres arrière... fixes. Son levier de vitesse en boule planté dans la planche de bord. La barre du milieu de la banquette arrière qui punissait le passager du centre. Les poignées de portes qui tournaient dans le vide une fois verrouillées : la 2CV était unique jusque dans ses moindres détails. Ces détails qui parlent à tous ceux qui ont connu la 2CV, qui sont un jour montés dans cette voiture si mollement suspendue qu'elle est la seule à ne pas s'être rendu compte de l'installation des ralentisseurs dans les années 1980. À cette époque, il est à peu près certain que tout le monde, en France, avait une histoire de 2CV dans sa famille.

Bourrée de défauts
Mais au fait, faut-il vraiment la regretter ? Faut-il regretter cette voiture jugée fort laide à sa sortie ? Dont le train avant avait du mal à passer une si modeste puissance (29 ch à la fin) ? Qui freinait à peine et dont la lourdeur de la direction laissait penser que la 2CV pesait au moins quatre fois sa demi-tonne ? Cette voiture bruyante et poussive, qui n'éclairait rien la nuit, dont les essuie-glace ne balayaient rien sous l'eau ? Dont les sièges en skaï brûlaient l'été ? Dont les panneaux de carrosserie droits et le châssis antique donnaient l'impression que l'engin allait se disloquer sur les plaques d'égout ? Et qui, contrairement à ce qu'en disent ceux qui l'ont idéalisée, n'avait rien de si économique : 44 800 francs en 1989 pour une Charleston, contre 46 600 francs pour une "moderne" Renault 5 Five qui consommait 20 % de carburant en moins.
Un morceau de l'histoire automobile française
Il ne faut assurément pas regretter ses prestations. Mais, comme une Coccinelle, une Mini, une Fiat 500 (les "vraies", pas les lourdes copies embourgeoisées des années 2000), la deux-pattes représente une époque et son pays. Elle était la voiture pour tous, sans distinction de classe sociale. Que l'on soit campagnard ou citadin. Que l'on soit ric-rac pour se l'offrir ou que l'on possède déjà une autre voiture, comme le suggérait ironiquement un autocollant souvent posé sur son postérieur : "mon autre voiture est une Rolls". Une voiture anti-frime, toute simple, à la fois si belle et si moche, qu'il serait vain d'essayer de faire revivre. La 2CV est partie voilà plus de 20 ans déjà. Citroën est passé à autre chose, et c'est sûrement très bien comme ça, même si certains ont vu dans la C3 de faux airs de la plus culte des voitures françaises.
Sous le capot de la 2CV Charleston
Cylindrée : 602 cm3
Type : 2 cylindres à plat, essence
Puissance : 29 ch à 5 750 tr/min
Couple : 39 Nm à 3 000 tr/min
Transmission : traction
Boîte : manuelle 4 vitesses
Dimensions (L/l/h) : 3 830 x 1 480 x 1 600 mm
Coffre : 220 l
Poids : 585 kg (20,17 kg/ch)
0-100 km/h : 33,5 s
Vitesse : 115 km/h
Consommation : 5,4 l à 90 km/h, 6,8 l en villeÉmissions de CO2 : NC
Prix en 1989 : 44 800 Francs (6 830 €)
-
CONTRE CIVITAS: SIGNER
L'UMP lance une pétition pour exiger un référendum à propos du mariage pour tous. Le referendum est impossible et la pétition est ridicule. L'UMP tend un bâton pour se faire battre , alors battons .
Signer la pétition contre le financement public de Civitas . -
LE MAL LOGEMENT

La Fondation Abbé Pierre publie son 18e rapport annuel vendredi 1er février. 59 ans, jour pour jour, après l'appel de l'Abbé Pierre.
3,6 millions de personnes non ou très mal logées
Pas de domicile, difficulté à le conserver quand on en a un, mauvaises conditions d'habitat... la Fondation Abbé Pierre rappelle dans son 18e rapport annuel que la situation est à la fois urgente et structurelle. "Les demandes d'hébergement reçues au 115 ont enregistré une hausse de 37% en novembre 2012 par rapport à novembre 2011", écrivent ses auteurs, précisant que "2012 a été difficile". "L'hébergement est sous pression", disent-ils, "et ne parvient pas à sortir d'une gestion saisonnière indexée sur la température."
133.000 personnes sans domiciles
Parmi elles 33.000 dorment dans des lieux non prévus pour l'habitation (cave, cage d'escalier, chantier, parking, centre commercial, grotte, tente, métro, gare) ou dans des centres d'hébergement d'urgence. 66.000 sont accueillis dans des établissements sociaux de longs séjours et 34.000 dans des dispositifs temporaires. Le dernier recensement de la population en 2006 a établi à 14.600 personnes le nombre de sans-abri, contre 9.000 en 1999.
411.000 personnes hébergées chez des tiers
Que ce soit des personnes entre 25 et 60 ans qui n'ont pas les moyens d'être indépendants et non aucun lien de parentés avec la personne qui les héberge (79.000), des enfants ou petit-enfants qui reviennent au domicile parental pour une raison autre que la fin des études (282.000), ou des personnes de plus de 60 ans, elles sont tous hébergées de façon contrainte, estime la fondation. Ces chiffres datent de 2002, et "de nombreuses alertes montrent que le phénomène a pris une réelle ampleur ces dix dernières années".
15.498 places en hôtel
"L'hôtel apparaît de plus en plus comme une situation de dernier recours pour assurer l'accueil d'urgence des personnes privées de domicile", écrivent les auteurs du rapport. 15.498 places fin 2011, contre 13.948 places fin 2010, et cela sans compter les places mises à disposition par les collectivités locales. L'essentiel se situe en Île-de-France (plus de 12.000), le reste en Rhône-Alpes, Lorraine et Picardie. Ces chambres d'un confort limité, servent à 90% à des personnes seules. "Cette solution apparaît très insatisfaisante pour les familles", explique la fondation, et elle est coûteuse : l'Etat y a consacré 95 millions d'euros en 2011, représentant 43% des dépenses d'hébergement d'urgence, "alors qu'elle devait être réduite à 25%".
Pour 3 Français sur 4, difficile de se loger
"Le situation est particulièrement dramatique pour les ménages les plus modestes, les isolés, les jeunes en difficulté d'insertion, les femmes avec enfants disposant de faibles ressources", explique la fondation Abbé Pierre... "Mais elle est aussi devenue complexe pour de nombreux ménages insérés socialement et économiquement". Discriminations dans l'accès au logement, demande qui a progressé de 43% en dix ans, témoignant d'une déconnexion forte entre les niveaux de loyer dans le parc privé et les ressources des ménages. Selon l'association, "le marché du logement fonctionne comme une véritable centrifugeuse qui sélectionne les candidats les plus solvables et refoule les autres vers les réponses apportées par la puissance publique. Notamment vers un parc HLM qui n'est pas calibré pour répondre à l'ensemble des besoins".
D'aprés LE NOUVEL OBS
-
DISCOURS DE CHRISTIANE TAUBIRA

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure pour avis, mesdames, messieurs les députés, nous avons l’honneur et le privilège, Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille, et moi-même, de vous présenter, au nom du Gouvernement, un projet de loi traduisant l’engagement du Président de la République d’ouvrir le mariage et l’adoption aux couples de même sexe.
S’agissant de l’état des personnes, ce sont donc principalement des dispositions du code civil relatives au mariage, à l’adoption et à l’attribution du nom de famille qui seront adaptées.Dominique Bertinotti et moi-même avons tenu à participer activement, dans le respect des prérogatives des parlementaires, aux deux séances de la commission des lois, puisque, à la suite des modifications du règlement de l’Assemblée nationale, c’est sur le texte issu des travaux de la commission que nous allons débattre pendant ces deux semaines, week-ends compris.
Nous n’avons jamais sous-estimé l’importance de cette réforme. C’est pourquoi nous avons accueilli avec le plus grand respect toutes les personnes qui ont accepté d’être auditionnées. Nous savons à quel point les travaux de la commission sont utiles. Ils ont amélioré le texte, et les dispositions qui y ont été introduites seront présentées par vos rapporteurs.Je voudrais m’arrêter un instant sur l’évolution du mariage, pour que nous comprenions mieux ce que nous sommes en train de faire.
Dans une maison qui aime tant à citer le doyen Jean Carbonnier, je ne vais pas déroger à la règle. En 1989, à l’occasion des travaux de réflexion sur le bicentenaire de la Révolution française, il définissait le mariage civil comme la « gloire cachée » de celle-ci. Il faisait évidemment allusion aux vifs débats qui ont accompagné l’instauration de ce mariage civil, sa dimension contractuelle, sa durée, c’est-à-dire la possibilité de divorcer. À cette époque, deux religions reconnaissent le divorce, la religion protestante et la religion juive, tandis que la religion catholique, majoritaire, déclare le mariage indissoluble. Le doyen Carbonnier considère donc que le constituant de 1791 a bien accompli une véritable révolution en instaurant le mariage civil. La sécularisation de ce mariage est ainsi consacrée dans la Constitution de 1791.
Le mariage civil porte l’empreinte de l’égalité. Il s’agit d’une véritable conquête fondatrice de la République, dans un mouvement général de laïcisation de la société.
Une telle conquête était importante essentiellement pour ceux qui étaient exclus du mariage à cette époque. Après la révocation de l’édit de tolérance, dit édit de Nantes, en 1685, les protestants ne pouvaient se marier qu’en procédant secrètement avec leurs pasteurs. Ils ne pouvaient pas constituer une famille et leurs enfants étaient considérés comme des bâtards. À partir de 1787, l’édit de tolérance autorise de nouveau les prêtres et les juges à prononcer ces mariages en tant qu’officiers de l’état-civil. Il y a donc une première ouverture, deux ans avant la Révolution, avec cette reconnaissance du pluralisme religieux et la possibilité d’inclure dans le mariage ceux qui en étaient exclus, à savoir les protestants et les juifs. Mais le mariage n’inclut encore que les croyants.
Il exclut aussi des professions, et notamment les comédiens, parce que la religion proclame qu’elle ne saurait reconnaître les pratiques infâmes des acteurs de théâtre. C’est d’ailleurs le comédien Talma qui va saisir la Constituante parce que le curé de Saint-Sulpice refuse de publier les bans de son mariage avec une « mondaine », comme on disait à l’époque.
Les constituants décident donc d’instaurer un mariage civil et inscrivent dans l’article 7 du titre II de la Constitution de septembre 1791 que le mariage n’est que contractuel et que le pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés et désignera les officiers chargés de constater et d’enregistrer ces actes.
Le mariage civil permet d’inclure des croyants non catholiques, mais il est élargi à tous, c’est-à-dire que tous ceux qui souhaitent se marier peuvent disposer des mêmes droits et doivent respecter les mêmes obligations.Cette conception du mariage civil, qui porte l’empreinte de l’égalité, est en fait essentiellement une liberté, parce que, dès l’instauration du mariage, le divorce sera également reconnu. Il est écrit dans l’exposé des motifs de la loi de 1792 que le divorce résulte d’une liberté individuelle, dont un engagement indissoluble serait la perte. Puisque le mariage est la liberté des parties et non la sacralisation d’une volonté divine, cette liberté de se marier ne se conçoit qu’avec la liberté de divorcer, et, parce que le mariage va se détacher du sacrement qui l’avait précédé, il pourra représenter les valeurs républicaines et intégrer progressivement les évolutions de la société.
La meilleure manifestation de cette liberté s’exprime par l’article 146 du code civil, qui n’a pas changé depuis son origine, et selon lequel il n’y a pas de mariage sans consentement. Cet article établit donc la pleine liberté de l’un et de l’autre conjoint dans le mariage.Si l’on se souvient que le mariage a d’abord été une union de patrimoines, d’héritages, de lignées, que l’on passait chez le notaire avant de passer chez le prêtre, le fait de reconnaître la liberté de chacun des conjoints est un progrès considérable, aujourd’hui encore inscrit dans le code civil.
Le divorce va donc accompagner très vite le mariage. Il sera prohibé en 1816, dans une ambiance où les courants conservateurs sont dominants et où les libertés, notamment celles des femmes, sont en régression. Il sera rétabli en 1884 par la loi Naquet, là encore dans un mouvement général contraire de laïcisation de la société. L’évolution du mariage porte en effet très fortement la marque de la laïcité, de l’égalité et de la liberté telles que ces valeurs ont évolué dans notre droit et dans notre société, dans une relation diachronique qui a connu parfois de très vives tensions. C’est donc dans un mouvement de laïcisation de l’état-civil, des libertés individuelles, de la société en général que le divorce sera restauré en 1884. C’est en effet au cours de cette décennie que d’autres lois de liberté individuelle, telles que la loi sur la presse, les lois relatives à la liberté d’association ou à la liberté syndicale, et bientôt la loi de séparation des églises et de l’État, vont intervenir. Le divorce sera consolidé en 1975 par le rétablissement du consentement mutuel, qui était déjà reconnu en 1792, comme d’ailleurs l’incompatibilité d’humeur.Le mariage, accompagné du divorce, reconnaît donc la liberté, y compris celle de ne pas se marier, et c’est la raison pour laquelle la loi reconnaît les familles en dehors du mariage et va progressivement reconnaître les enfants de ces familles. Le mariage, qui a réussi à se détacher du sacrement, va en effet se détacher également d’un ordre social fondé sur une conception patriarcale de la société, conception qui fait du mari et du père le propriétaire, le possesseur du patrimoine, bien entendu, mais aussi de l’épouse et des enfants.
Cette évolution du mariage et du divorce, qui permettra dorénavant aux couples de choisir librement l’organisation de leur vie, sera inscrite dans la loi parce que, depuis deux siècles, l’institution du mariage connaît une évolution vers l’égalité, et c’est bien ce que nous sommes en train de faire aujourd’hui : parachever l’évolution vers l’égalité de cette institution née avec la laïcisation de la société et du mariage.
Cette évolution va concerner d’abord les femmes, avec la suppression de la référence au chef de famille, la reconnaissance de la communauté de vie, la loi de 1970 puis celle de 1975, qui va réintroduire le consentement mutuel. La reconnaissance des droits des femmes sera inscrite progressivement dans la loi. L’année 1970, c’était il y a à peine une quarantaine d’années, c’est-à-dire que vivent encore aujourd’hui des femmes qui ont eu besoin de l’autorisation de leur époux pour ouvrir un compte bancaire, souscrire un contrat, disposer de leur salaire et donc être reconnue comme sujet de droit.
Cette évolution vers l’égalité, qui va moderniser notre institution du mariage en reconnaissant la femme comme sujet de droit, va reconnaître aussi progressivement les droits des enfants. Par la loi de 1972, le législateur cessera d’établir une différence entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Il procédera donc à une refonte de la filiation, de façon à reconnaître une égalité des droits pour les enfants, que leur filiation soit légitime ou naturelle.
En 2000, c’est un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’arrêt Mazurek, qui contraindra la France à mettre un terme aux discriminations imposées aux enfants adultérins, et c’est seulement par une ordonnance de 2005, ratifiée par une loi de 2009, que les notions d’enfant légitime et d’enfant naturel vont disparaître de notre code civil. L’enfant devient donc également un sujet de droit.
En vous présentant aujourd’hui ce projet de loi, qui contient des dispositions ouvrant le mariage et l’adoption à droit constant aux couples homosexuels, le Gouvernement choisit de permettre aux couples de même sexe d’entrer dans cette institution et de composer une famille comme les couples hétérosexuels, soit par une union de fait, que l’on appelle le concubinage, soit par un contrat, le PACS, soit par le mariage.
C’est bien cette institution que le Gouvernement a décidé d’ouvrir aux couples de même sexe. C’est un acte d’égalité. Il s’agit du mariage tel qu’il est institué actuellement dans notre code civil. Il ne s’agit pas d’un mariage au rabais, il ne s’agit pas d’une union civile prétendument aménagée. Il ne s’agit pas non plus d’une ruse, d’une entourloupe, il s’agit du mariage en tant que contrat entre deux personnes, en tant qu’institution produisant des règles d’ordre public.Oui, c’est bien le mariage, avec toute sa charge symbolique et toutes ses règles d’ordre public, que le Gouvernement ouvre aux couples de même sexe, dans les mêmes conditions d’âge et de consentement de la part de chacun des conjoints, avec les mêmes interdits, les mêmes prohibitions, sur l’inceste, sur la polygamie, avec les mêmes obligations d’assistance, de fidélité, de respect, instaurées par la loi de 2006, avec les mêmes obligations pour chaque conjoint vis-à-vis l’un de l’autre, les mêmes devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents et des parents vis-à-vis de leurs enfants.
Oui, c’est bien ce mariage que nous ouvrons aux couples de même sexe. Que l’on nous explique pourquoi deux personnes qui se sont rencontrées, qui se sont aimées, qui ont vieilli ensemble devraient consentir à la précarité, à une fragilité, voire à une injustice, du seul fait que la loi ne leur reconnaît pas les mêmes droits qu’à un autre couple aussi stable qui a choisi de construire sa vie.
Qu’est-ce que le mariage homosexuel va enlever aux couples hétérosexuels ? S’il n’enlève rien, nous allons oser poser des mots sur des sentiments et des comportements. Nous allons oser parler de mensonges à l’occasion de cette campagne de panique, sur la pseudo-suppression des mots de « père » et de « mère » du code civil et du livret de famille. Nous posons les mots et nous parlons d’hypocrisie pour ceux qui refusent de voir ces familles homoparentales et ces enfants, exposés aux aléas de la vie. Nous posons les mots et nous parlons d’égoïsme pour ceux qui s’imaginent qu’une institution de la République pourrait être réservée à une catégorie de citoyens. Nous disons que le mariage ouvert aux couples de même sexe illustre bien la devise de la République. Il illustre la liberté de se choisir, la liberté de décider de vivre ensemble. Nous proclamons par ce texte l’égalité de tous les couples, de toutes les familles.
Enfin, nous disons aussi qu’il y a dans cet acte une démarche de fraternité, parce qu’aucune différence ne peut servir de prétexte à des discriminations d’État. Au nom d’un prétendu droit à l’enfant qui n’existe pas, vous protestez parce que le mariage et l’adoption sont ouverts aux couples de même sexe dans exactement les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels. Autrement dit, ou bien vous nous affirmez que les couples hétérosexuels ont un droit à l’enfant inscrit dans le code civil, ou bien ce droit à l’enfant n’existe pas – et de fait il n’existe pas – et les couples homosexuels auront le droit d’adopter dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels.Au nom d’un prétendu droit à l’enfant, vous refusez des droits à des enfants que vous choisissez de ne pas voir. Le texte que nous vous présentons n’a rien de contraire à la Convention internationale des droits de l’enfant. Au contraire, il protège des enfants que vous refusez de voir.
Les couples homosexuels pourront adopter dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels, selon les mêmes procédures : l’agrément sera accordé dans les mêmes conditions par les conseils généraux, l’adoption prononcée dans les mêmes conditions par le juge, conformément à l’article 353 du code civil, qui dispose que l’adoption est prononcée si elle est conforme aux droits de l’enfant. Par conséquent, vos objections n’ont pas de fondement, si ce n’est une réelle difficulté à inclure dans vos représentations la légitimité de ces couples de même sexe. Or vos enfants et petits-enfants les incluent déjà et les incluront de plus en plus. Et vous serez bien mal à l’aise lorsque, par curiosité, ils liront les comptes rendus de nos débats !Nous avons donc décidé d’ouvrir le mariage et l’adoption aux couples de même sexe. Le mariage, comme je l’ai montré références historiques et juridiques à l’appui, a été une institution de propriété puisqu’il a d’abord servi à marier des patrimoines, des héritages et des lignées. Il a été une institution de possession puisque le mari et père avait une autorité absolue sur l’épouse et les enfants. Il a été une institution d’exclusion, nous l’avons vu : le mariage civil a mis un terme à l’exclusion des croyants non catholiques et de certaines professions, donc de toute une série de citoyens. Ce mariage, qui a été une institution d’exclusion, va enfin devenir, par l’inclusion des couples de même sexe, une institution universelle. Enfin, le mariage devient une institution universelle !
Vous pouvez continuer à refuser de voir, à refuser de regarder autour de vous, à refuser de tolérer la présence, y compris près de vous, y compris, peut-être, dans vos familles, de couples homosexuels.
Vous pouvez conserver le regard obstinément rivé sur le passé, et encore, en regardant bien le passé, y trouverez-vous des traces durables de la reconnaissance officielle, y compris par l’Église, de couples homosexuels.Vous avez choisi de protester contre la reconnaissance des droits de ces couples ; c’est votre affaire. Nous, nous sommes fiers de ce que nous faisons.
Nous en sommes si fiers que je voudrais le définir par les mots du poète Léon-Gontran Damas : l’acte que nous allons accomplir est « beau comme une rose dont la tour Eiffel assiégée à l’aube voit s’épanouir enfin les pétales ». Il est « grand comme un besoin de changer d’air ». Il est « fort comme le cri aigu d’un accent dans la nuit longue ». -
LA HAINE :JUSQU'OU
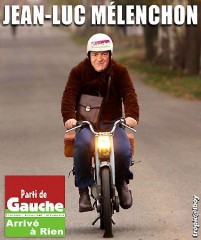
Si il y a des désaccords à gauche , c'est normal mais depuis l'élection de François Hollande c’est même la première fois qu’un gouvernement de gauche gouverne avec une telle déloyauté et haine sur sa gauche.
François Hollande doit tenir compte d’une opposition inédite, que les médias trop rapidement incarnent en la personne de Jean-Luc Mélenchon.
Je ne suis pas étonné de cette haine mais déçu par la violence d'une telle opposition de gauche
Soit l’extrême gauche,a toujours considèré l’UMP et le PS comme des partis à combattre en bloc. Mais comment peut-on espérer triompher, entraîner, voire unir, dans ce classe contre classe d’un autre temps .
La politique est un mélange de convictions et d’actions.
Mais qui est donc le plus à gauche ? Celui qui se cogne au réel et qui agit ou celui qui en parle sans autre limite que sa pensée ? Le débat est sans fin. Il est presque sans intérêt de le voir se limiter à quelques oukazes verbales du YaKaFoKon habituel.
La politique est une question d’alternative:
comprendre le réel
comprendre nos choix
-
UNITAIRE POUR DEUX

A la reunion des secrétaires de section du P. S à laquelle j'ai assisté ce samedi il y a une formule de François Mitterrand qui m'ai révenu quand nos dirigeants parlaient d'union de toute la gauche pour les prochaines élections : "Il faut être unitaire pour deux" A l'époque, dans les années 70, le PCF tapait déjà trés dur sur le PS, Mitterrand voulait dire qu'il était unitaire pour lui et pour eux, à la place des communistes, et je ne comprenais mal qu'on puisse être unitaire pour quelqu'un qui ne le veut pas !. Et puis, l'unité a fini par l'emporter, Mitterrand est devenu président, et les communistes qui tapaient encore plus fort contre lui sont entrés ... dans son gouvernement ! Il y a aussi des miracles en politique ...
"Etre unitaire pour deux", la formule m'a marqué, j'y pense encore aujourd'hui, et je crois au miracle en politique.


